
Louis Clensy Appavoo, expert-comptable, auditeur et CEO de HLB Mauritius, livre son diagnostic franc sur le séisme institutionnel et financier qui frappe le pays. Il explique sans détour comment la Mauritius Investment Corporation, censée soutenir l’économie nationale, est devenue un symbole de dérives en matière de gouvernance. De l’indépendance compromise de la Banque de Maurice aux difficultés structurelles d’Air Mauritius, en passant par la gestion opaque des prix du carburant, Clensy Appavoo pose les questions qui dérangent : quelle crédibilité reste-t-il aujourd’hui à nos institutions économiques, et comment rétablir la confiance après une telle crise ?
Un ancien ministre des Finances et un ancien Gouverneur de la Banque centrale – deux figures censées incarner l’orthodoxie financière – sont aujourd’hui poursuivis pour fraude. Auriez-vous imaginé qu’un tel scénario puisse se produire à Maurice ?
Comme beaucoup de Mauriciens, je suis d’abord très choqué. À première vue, une telle situation aurait pu paraître hautement improbable dans une démocratie réputée stable comme Maurice, souvent présentée comme un modèle de gouvernance dans l’océan Indien. Voir un ancien ministre des Finances – en l’occurrence Renganaden Padayachy – et un ancien Gouverneur de la Banque de Maurice – Harvesh Seegolam – se retrouver dans le viseur de la justice pour des faits de fraude remet profondément en question les standards d’éthique auxquels on aurait pu s’attendre de la part de ces hauts responsables publics.
Publicité
Tous deux ont occupé des postes stratégiques au sein des institutions les plus sensibles de la République : le ministère des Finances, en tant que moteur des politiques économiques, budgétaires et fiscales, et la Banque centrale, garante de la stabilité monétaire et de l’indépendance financière du pays. Ces institutions représentent traditionnellement les bastions de l’orthodoxie économique, où la rigueur, la neutralité et la transparence ne sont pas que des vertus théoriques mais des obligations fonctionnelles.
Le fait que de telles accusations émanent aujourd’hui des propres institutions de l’État – la Financial Crimes Commission (FCC) nouvellement créée – marque un tournant inédit dans l’histoire institutionnelle de Maurice. Cela pose de sérieuses interrogations sur le système de ‘checks and balances’ et sur l’étendue de la politisation de nos organes économiques. En somme, ce qui nous interpelle, c’est moins la surprise du scandale en lui-même que la profondeur du choc institutionnel qu’il provoque.
Pensez-vous que les dénonciations formulées durant la campagne électorale avaient déjà esquissé les contours de ce scénario aujourd’hui devenu réalité ?
Avec le recul, je vous dirai qu’il est clair que la campagne électorale a été le théâtre de nombreuses allusions, parfois explicites, aux dysfonctionnements internes de l’appareil d’État, notamment dans la gestion des fonds publics pendant la pandémie. L’opposition comme plusieurs organisations de la société civile avaient soulevé des zones d’ombre autour de la Mauritius Investment Corporation (MIC), entité créée sous l’égide de la Banque de Maurice et opérant sans véritable supervision parlementaire.
La MIC, dotée de centaines de millions de roupies issues des réserves de la Banque centrale, devait initialement aider les entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Toutefois, dès 2021, plusieurs voix ont pointé du doigt l’absence de transparence dans l’attribution des fonds, la nature des investissements réalisés, et le flou juridique autour de sa création. Dans ses discours, l’opposition a fréquemment accusé le gouvernement d’avoir transformé la MIC en « caisse noire » au service d’intérêts particuliers.
Ces critiques, bien que politiquement motivées dans un contexte électoral, semblent aujourd’hui prendre une dimension plus concrète. Les procédures judiciaires engagées viennent donner du crédit aux soupçons exprimés alors. On peut ainsi considérer que la campagne électorale n’a pas seulement préparé le terrain politique, mais aussi ouvert un espace pour des enquêtes en profondeur sur des institutions jusqu’alors peu remises en question.
En tant qu’expert-comptable, auditeur et connaisseur des rouages financiers, comment analysez-vous le choc institutionnel que représente l’affaire MIC pour la Banque de Maurice ?
D’un point de vue technique en tant que professionnel de la Finance, je trouve que l’affaire MIC est une secousse sismique au cœur même du système financier mauricien. La Banque de Maurice, en tant qu’autorité monétaire, est censée incarner l’indépendance, la discipline macroéconomique et la stabilité du système bancaire. En créant la MIC, elle a étendu son rôle traditionnel à celui d’investisseur stratégique – ce qui en soi est déjà inhabituel, voire problématique.
Ce glissement de mandat a brouillé la frontière entre régulation et interventionnisme économique. En effet, une banque centrale est censée agir comme garant du système, non comme acteur à part entière dans la redistribution des fonds. En injectant massivement des fonds à travers une entité ‘ad hoc’ comme la BoM l’a toujours appelé, en dehors du cadre budgétaire, sans réelle reddition de comptes au Parlement ou au public, la Banque de Maurice a fragilisé sa propre légitimité.
Le fait que des accusations de fraude et de collusion impliquent aujourd’hui l’ancien Gouverneur montre à quel point l’indépendance de l’institution a pu être compromise par des pressions politiques. Cette situation envoie également un signal préoccupant aux marchés financiers et aux investisseurs étrangers, pour qui l’indépendance des institutions est une condition fondamentale de la confiance.
Enfin, sur le plan des bonnes pratiques en matière de gouvernance, l’affaire MIC révèle une grave lacune : l’absence de mécanismes de surveillance interne solides et d’un cadre juridique robuste pour encadrer les interventions non conventionnelles de la Banque centrale.
L’ancien Gouverneur a reconnu devant la FCC avoir plié sous la pression du ministre des Finances. Un haut responsable, placé à la tête d’une institution censée être indépendante, peut-il se permettre une telle concession ? Qu’est-ce qu’il aurait dû faire ?
Dans tous les systèmes démocratiques et économiquement stables, la Banque centrale agit comme un contre-pouvoir technique au service de l’intérêt général. Son Gouverneur ne rend de comptes qu’au cadre légal qui définit ses prérogatives – pas à un ministre, et encore moins à un agenda politique.
Quoique dise l’ex-Gouverneur, il est clair et indéniable qu’en acceptant des instructions de nature politique ou en se laissant dicter une ligne d’action contraire à son mandat, le gouverneur aurait, de facto, trahi sa mission. Il ne s’agit pas simplement d’une faute administrative, mais d’une dérive grave aux implications macroéconomiques : perte de confiance dans la gestion monétaire, risques inflationnistes liés à une création monétaire incontrôlée, et affaiblissement de la crédibilité du pays sur le plan international.
La question pertinente qui se pose dans les circonstances est la suivante : Qu’est-ce qu’il aurait dû faire ? La réponse est simplement ‘résister, alerter le Conseil d’administration de la Banque, consigner par écrit son désaccord, et – en ultime recours – démissionner’. L’éthique professionnelle exige parfois des choix douloureux mais nécessaires pour protéger l’intégrité d’une institution. Son aveu de soumission, même a posteriori, met en lumière les dangers d’une gouvernance fondée sur l’obéissance politique plutôt que sur la responsabilité technique.
Comment réagissez-vous à ses déclarations selon lesquelles une proposition financière illicite de Rs 5 millions lui aurait été faite par l’ancien ministre des Finances pour faciliter un dossier ? Ce type de témoignage change-t-il la perception que l’on doit avoir des pratiques en haut lieu ?
Si ces allégations sont avérées, elles constituent non seulement une infraction pénale grave, mais aussi un signal d’alarme quant à la culture de gouvernance à haut niveau. La tentative supposée de corruption, émanant d’un ministre à l’égard d’un Gouverneur de la Banque centrale, montre que certaines pratiques informelles, jusqu’ici reléguées au rang de rumeurs, pourraient bien être ancrées dans les sphères décisionnelles.
Ce type de déclaration, même s’il devra être prouvé en justice, a un effet corrosif sur la confiance du public. Il érode la croyance en une méritocratie républicaine et alimente un cynisme généralisé. Il est urgent, dans ce contexte, que les institutions judiciaires poursuivent leurs travaux sans interférence politique, pour restaurer un minimum de confiance dans le processus démocratique et dans la fonction publique.
Depuis 2014, chaque transition gouvernementale s’accompagne d’un cortège d’arrestations ciblant des figures de l’ancien régime. Cette dynamique répétée pourrait-elle finir par instaurer une culture de redevabilité et un réflexe de bonne gouvernance ?
Dans les démocraties matures, la peur des sanctions légales constitue un puissant outil de dissuasion contre les dérives de pouvoir. Mais dans le contexte mauricien, la répétition de ces dynamiques – arrestations sélectives, mise en scène médiatique, lenteurs procédurales – tend plutôt à produire un effet inverse : la banalisation du soupçon et la polarisation de l’opinion.
L’idée que chaque nouveau pouvoir utilise les institutions judiciaires pour régler ses comptes avec l’ancien affaiblit l’image d’un État impartial. Ce qui devrait être perçu comme une avancée vers la transparence devient perçu comme un rituel politisé, où l’enjeu n’est plus la justice, mais la domination narrative.
Cela ne veut pas dire que les affaires révélées sont infondées – bien au contraire. Mais l’absence d’un mécanisme indépendant, au-dessus des clivages partisans, pour superviser ces enquêtes, nuit à leur légitimité. Pour instaurer une vraie culture de redevabilité, il faut dépasser la logique du « deux poids, deux mesures » et faire preuve d’universalité dans l’application de la loi, qu’il s’agisse des anciens ou des actuels détenteurs du pouvoir.
Les premières enquêtes de la FCC se concentrent sur les décisions et les figures clés de l’ancien gouvernement. Est-ce, à vos yeux, une opération de nettoyage nécessaire ou une séquence qui risque d’alimenter le soupçon d’instrumentalisation politique des institutions ?
Il y a ici une tension entre deux lectures possibles de l’action de la Financial Crimes Commission. La première lecture est optimiste : elle y voit une opération de salubrité publique, un « nettoyage » des pratiques douteuses ayant entaché l’administration précédente, notamment autour de la MIC, des passations de marchés durant la pandémie, ou encore des nominations controversées. Une justice qui agit, surtout contre des personnalités de haut rang, est un signal fort que l’impunité ne peut perdurer indéfiniment.
Mais la seconde lecture, plus sceptique, soulève des inquiétudes sur le calendrier et la sélectivité apparente des enquêtes. Lorsque la FCC concentre toute son attention sur les acteurs de l’ancien régime, sans s’intéresser aux pratiques actuelles, le soupçon d’instrumentalisation devient inévitable. La perception publique – et cela compte autant que la réalité judiciaire – est alors celle d’un outil aux mains du pouvoir en place.
Pour éviter que cette séquence ne bascule dans une guerre politique déguisée en chasse à la corruption, il est impératif que la FCC démontre son indépendance, en poursuivant également des affaires liées à l’administration actuelle si des éléments probants existent. La justice ne peut être à géométrie variable. Autrement, elle perd sa légitimité et devient un acteur politique, au lieu d’être un arbitre impartial.
Le passage de l’Icac à la FCC a été présenté comme un tournant dans la lutte contre la corruption. Qu’est-ce qui a véritablement changé ?
Le remplacement de l’Independent Commission against Corruption (Icac) par la FCC a été salué comme une réforme structurelle visant à redonner confiance dans la lutte contre la corruption. Il est vrai que l’Icac avait fini par cristalliser de nombreuses critiques : manque d’indépendance, lenteur d’action, perception d’inaction dans certains dossiers sensibles, et soupçons d’allégeance politique.
La FCC, de par son mode de nomination, son champ d’action élargi et ses pouvoirs accrus en matière de gel d’avoirs et de coopération internationale, était censée rompre avec cette image dégradée. L’une des différences fondamentales réside dans son approche plus intégrée de la criminalité financière, mêlant investigations, poursuites et surveillance.
Mais dans la pratique, ce changement institutionnel n’aura d’effet durable que s’il s’accompagne d’un changement de culture. Une loi peut doter un organisme de nouveaux outils, mais c’est la volonté politique, la compétence des équipes, et surtout leur indépendance réelle qui détermineront la réussite.
À ce stade, il est encore trop tôt pour juger du bilan de la FCC. Son action dans les mois à venir, notamment sa capacité à poursuivre des dossiers sensibles, à éviter les fuites sélectives vers la presse, et à traiter tous les citoyens avec impartialité, sera le véritable test. Une institution ne devient crédible qu’en faisant la preuve de sa neutralité et de son efficacité, pas uniquement par le biais d’un rebranding.
Parlons d’Air Mauritius… Autrefois qualifiée de « cash cow » avec ses « caisses noires », elle est aujourd’hui sous respiration artificielle. Comment expliquer cette dégringolade ?
La chute d’Air Mauritius est le produit d’un cocktail toxique entre erreurs stratégiques accumulées sur plusieurs décennies, une gouvernance déficiente, une gestion politisée, et des chocs exogènes comme la pandémie de COVID-19. Loin d’être une simple entreprise commerciale, la compagnie aérienne nationale a souvent servi d’instrument politique et diplomatique, ce qui a nui à sa rentabilité structurelle.
Pendant des années, la direction de la compagnie a été influencée par des logiques de clientélisme, de favoritisme dans les nominations, et de choix d’itinéraires motivés moins par la viabilité commerciale que par des considérations d’image ou de politique étrangère. À cela se sont ajoutés une mauvaise gestion des flottes, des coûts d’exploitation élevés, des partenariats peu transparents, et des politiques tarifaires mal calibrées.
La pandémie n’a fait qu’accélérer l’effondrement. En 2020, la compagnie s’est placée sous administration volontaire, un aveu d’échec qui a marqué un tournant historique. Aujourd’hui, Air Mauritius ne doit sa survie qu’à l’appui de l’État, à travers des injections de fonds directs ou indirects, ce qui pose la question de la soutenabilité à long terme de son modèle.
La compagnie nationale est aujourd’hui dirigée par un président du conseil d’administration très présent, mais toujours sans CEO officiellement nommé. Ce mode de gouvernance vous paraît-il viable pour mener une restructuration ambitieuse ?
La situation actuelle d’Air Mauritius, avec un président du conseil d’administration occupant un rôle opérationnel sans qu’un CEO permanent n’ait encore été nommé, est atypique – voire problématique – dans le contexte d’une entreprise publique en pleine phase de restructuration. Cette configuration brouille la ligne de démarcation entre les fonctions de gouvernance stratégique et de gestion exécutive, deux rôles qui doivent rester distincts pour garantir l'efficacité, la transparence et la reddition de comptes.
Selon mon expérience professionnelle de la gestion à haut niveau, toute entreprise, et plus encore dans une compagnie aérienne aux défis techniques, financiers et logistiques multiples, le CEO est le chef d’orchestre opérationnel. Il incarne la stratégie au quotidien, prend les décisions exécutives, gère les risques et pilote les transformations. Le président, lui, devrait se limiter à la supervision, au contrôle, et à la relation avec les parties prenantes. Lorsque le président se substitue de facto au CEO, sans avoir la responsabilité formelle ni la redevabilité d’un manager exécutif, le risque est triple : dilution des responsabilités, confusion dans la chaîne hiérarchique, et affaiblissement de la culture managériale.
Or, pour qu’Air Mauritius puisse renouer avec une logique de performance, il faut une vision claire, un leadership professionnel et une capacité de pilotage agile. Cela passe par la nomination urgente d’un CEO expérimenté, indépendant des pressions politiques, et doté de la légitimité nécessaire pour mener des réformes douloureuses. Sans ce leadership exécutif affirmé, aucune restructuration ne peut être crédible, et les réformes resteront cosmétiques
Peut-on, dans les conditions actuelles du marché aérien et avec les contraintes spécifiques à Maurice, imaginer un retour à la rentabilité d’Air Mauritius sans recours à des subventions publiques régulières ?
Le retour à la rentabilité d’Air Mauritius, sans perfusion étatique, est une ambition légitime mais hautement complexe. Il faut d’abord reconnaître les contraintes structurelles propres à une compagnie insulaire : une base de clientèle relativement limitée, une dépendance extrême au tourisme international, un coût élevé du carburant (surtout avec les taxes locales), et une concurrence féroce sur les lignes long-courriers par des géants aux poches profondes comme Emirates ou Turkish Airlines.
Cela étant dit, la rentabilité n’est pas impossible. Elle dépend de plusieurs facteurs interdépendants : (i) un repositionnement stratégique clair (ii) une gestion rigoureuse des coûts (iii) une gouvernance modernisée et (iv) l’innovation et la digitation avec un tarification dynamique
Cependant, dans l’immédiat, un certain niveau de soutien étatique peut s’avérer inévitable, ne serait-ce que pour préserver la connectivité stratégique de Maurice. L’enjeu est d’éviter que cette aide ne se transforme en dépendance chronique. L’État doit fixer une feuille de route claire et exigeante, avec des indicateurs de performance et une échéance pour atteindre l’équilibre financier. L’objectif : une compagnie plus petite, mais plus agile, plus rentable et mieux ancrée dans un écosystème aérien régional.
Peut-on attribuer ces secousses au fait que plusieurs postes de responsabilité continuent d’être attribués sur des critères politiques au détriment de la compétence ?
Absolument ! L’une des causes profondes des secousses actuelles – qu’il s’agisse de la gestion d’Air Mauritius, de la controverse autour de la MIC, ou de la stagnation de certains secteurs stratégiques – réside dans la politisation excessive des nominations dans les institutions publiques et parapubliques. Cette pratique, ancrée dans notre culture politique depuis des décennies, a malheureusement affaibli la performance de plusieurs structures étatiques.
Les critères de compétence, d’expérience sectorielle, de leadership et d’indépendance sont trop souvent sacrifiés sur l’autel du favoritisme, du clientélisme ou du retour d’ascenseur électoral. Il en résulte des nominations de convenance, où les profils choisis n’ont parfois ni la capacité stratégique, ni la maîtrise technique nécessaire pour piloter des entités complexes.
Cette réalité a trois conséquences néfastes :
un affaiblissement des institutions, qui peinent à prendre des décisions fondées sur des critères objectifs ;
un climat d’instabilité managériale, où les directions changent au gré des élections ou des alliances ;
une perte de confiance citoyenne, dès lors que les nominations ne répondent pas à des standards de mérite.
Il est urgent de rompre avec ce mode opératoire. La mise en place de comités de sélection indépendants, de procédures d’appel à candidatures transparentes et de critères d’évaluation clairs est indispensable. C’est à ce prix que Maurice pourra professionnaliser ses structures publiques, garantir une continuité stratégique, et éviter les dérives observées ces dernières années.
Malgré la baisse des cours internationaux du pétrole, les prix à la pompe restent élevés à Maurice. Est-ce que les justifications avancées par le ministère du Commerce vous ont convaincu ?
Les justifications avancées par le ministère du Commerce pour maintenir des prix élevés à la pompe, malgré la décrue des cours internationaux, peinent à convaincre pleinement, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Le gouvernement invoque principalement le mécanisme du Price Stabilisation Account (PSA) – une sorte de « tirelire » destinée à absorber les fluctuations des prix du carburant – ainsi que la nécessité de combler les pertes accumulées durant la période où les prix mondiaux étaient plus élevés.
Or, ce mécanisme est devenu opaque dans son fonctionnement. Les montants exacts accumulés ou ponctionnés, les critères d’ajustement, et l’équilibre entre recettes et compensations ne sont que partiellement publiés. Cette absence de transparence alimente une défiance croissante dans l’opinion publique. Il est difficile d’expliquer pourquoi les prix à la pompe restent au-dessus de Rs 70/litre quand le baril de Brent est redescendu sous les 85 dollars, sauf à admettre que la taxation indirecte est devenue un outil budgétaire plutôt qu’un outil de stabilisation.
Il est urgent que le gouvernement publie un audit indépendant du PSA, et qu’il envisage une réforme du système de fixation des prix, pour qu’il reflète mieux les tendances internationales, tout en garantissant un minimum de prévisibilité pour les consommateurs.
Le modèle actuel de fixation des prix de l’essence – via le Price Stabilisation Account et d’autres mécanismes – est-il encore pertinent ou faudrait-il envisager une réforme pour mieux refléter les tendances internationales ?
Le modèle actuel de fixation des prix du carburant à Maurice, basé sur le Price Stabilisation Account (PSA) et géré par la State Trading Corporation (STC), montre aujourd’hui ses limites. Pensé initialement comme un mécanisme d’amortissement des hausses et des baisses internationales des prix du pétrole, il a progressivement été détourné de sa fonction première pour devenir une source quasi-fiscale de revenus pour l’État.
Ce système souffre de trois défauts majeurs :
- Un manque de transparence : les calculs exacts du PSA ne sont ni régulièrement publiés, ni soumis à une vérification indépendante. Les montants accumulés ou utilisés, les marges imposées par la STC, et la manière dont sont calibrés les prix à la pompe restent flous pour les citoyens.
- Une inertie tarifaire : contrairement à d’autres pays qui ajustent les prix de manière hebdomadaire ou mensuelle en fonction du marché international, Maurice affiche une rigidité extrême. Cette lenteur pénalise les consommateurs en période de baisse des cours.
- Une logique de maximisation fiscale : les multiples prélèvements (taxe carbone, levy sur le sucre, contributions sociales, etc.) ont transformé le litre d’essence en produit hautement taxé, ce qui éloigne le prix final de toute réalité économique.
Face à ces constats, une réforme s’impose. Il serait judicieux de repenser le système autour de trois axes : (i) un mécanisme de prix flottant, mis à jour régulièrement, (ii) un PSA limité dans son usage et contrôlé par une autorité indépendante, et (iii) une transparence accrue dans les marges et les prélèvements. L’objectif est de garantir une certaine prévisibilité pour les usagers tout en permettant à l’État de maintenir un filet de sécurité budgétaire. Le prix de l’essence ne peut continuer à être un outil de taxation déguisé.

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !


















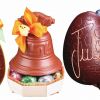

![[Info Soirée] : « bizin pa negliz bann slow learners »](https://defimedia.info/sites/default/files/styles/square_thumbnail/public/thumbnail_190425.jpg?itok=J--MzK_k)
